Glossaire
Aqueduc : Canal
(surtout à l’air libre et surélevé) destiné
à conduire l’eau d’un lieu à un autre. Barbacane : Ouvrage
avancé souvent garni de meurtrières servant à défendre une porte ou un pont.
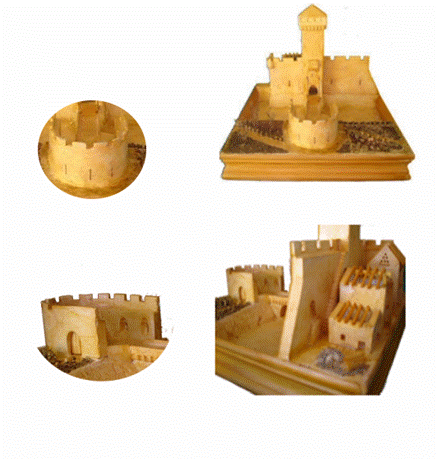

![]()
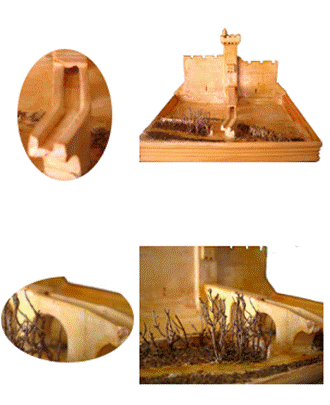
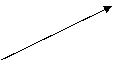

Bailli : Officier d’épée ou de robe, qui en
France rendait la justice au nom du roi ou d’un seigneur. Les baillis étaient des
fonctionnaires salariés et révocables, qui avaient pour mission de
représenter la royauté dans les provinces et d’exercer un contrôle sur les officiers
locaux d’origine féodale. Ils avaient pour similaires dans le midi les
sénéchaux.
Beffroi : Le
beffroi était une tour de ville dans laquelle on plaçait des gardes, qui
faisaient le guet jour et nuit, pour surveiller la campagne, et une cloche
qui servait à la fois à sonner l’alarme et à convoquer les hommes de la
commune.

![]()
Bretèche : Les bretèches
surplombaient surtout les ouvertures de la muraille, portes ou fenêtres.
Leur sommet et ouvert et crénelé, ou couvert d’un toit. Elles on les mêmes
fonction que les hourds.


![]()
Charte : Ancien titre concédant
des franchises, des privilèges. Le mot charte (autrefois. Chartre) se dit
des anciens livres et papiers relatifs à l’histoire, au droit public, etc.,
ou appartenant à une ville, à une communauté, etc. Mais on donne surtout ce
nom à l’acte en vertu duquel certaines libertés fondamentales sont
octroyées au peuple.
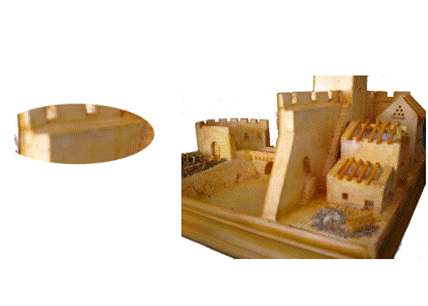
![]()
Corps
de garde : Poste
militaire Cloître
: Partie
d’un monastère formée de galeries couvertes, encadrant une cour ou un
jardin. Les
cloîtres étaient établis à côté des églises, des cathédrales, des
monastères et étaient d’une forme généralement carrée. Couvent : Maison
de religieux, religieuses, (du lat ; conventus, assemblée). Chaque
couvent renfermait nécessairement : 1,
l’église et le chœur, où les religieux
chantaient les offices. 2,
le chapitre, salle de réunion commune. 3,
les cellules. 4,
le réfectoire commun. 5,
la bibliothèque. 6,
l’infirmerie. 7,
le parloir, pour les relations avec les étrangers. 8,
le cloître. 9,
le caveau des morts, ou sépulture commune. Créneau : Maçonnerie
dentelée au haut des murs d’une muraille, d’une tour, permettant au
défenseur de tirer à couvert. Consul : Au
Moyen-Âge, nom donné à certains magistrats municipaux.
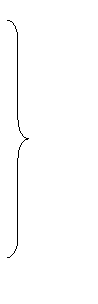
![]()
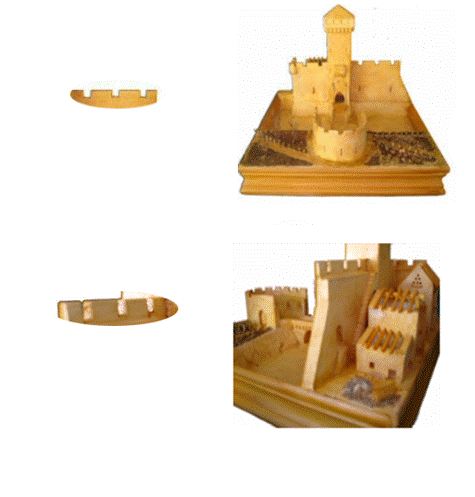


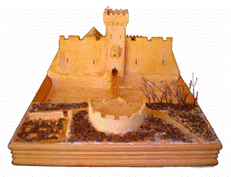
![]()
![]()
![]()
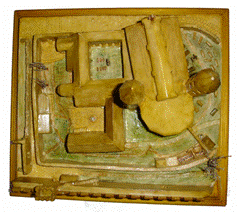
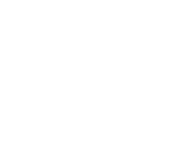
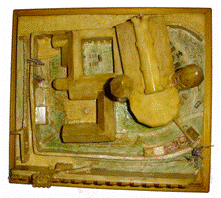
![]()

Donjon : Le
donjon, tour carrée de forte puissance, était composé en trois
parties : Le rez-de-chaussée : Dépourvu d’aucune ouverture sur
l’extérieur ; il servait de cave et parfois de cachot. On y accédait
que par un escalier à partir du 1er étage. Le 1er étage : C’est dans cette salle que
se trouvait la poterne qui donnait accès au donjon après avoir franchi un
pont-levis ou une passerelle de bois. Cette salle était généralement
réservée aux gardes. Le 2e étage : Salle plus ajourée et plus
confortable, qui servait de salle d’apparat où les seigneurs recevaient
leurs hôtes. La terrasse :
La terrasse était équipée d’un crénelage, et renforcée de hourds ou de
mâchicoulis. Elle était recouverte d’une charpente. Entrée du donjon
![]()


![]()

Douve : Les
douves,fossés remplis d’eau, font parties des moyens de défense d’une cité
ou d’un château rendant l’approche des murs ou des tours très difficile
pour les attaquants.
![]()
![]()
Echauguette : Petite loge
destinée aux sentinelles, les échauguettes étaient construites en
maçonnerie, en saillie sur les tours, les angles des fortifications et les
courtines. En temps de guerre des échauguettes en bois étaient disposées en
encorbellement sur les crénelages. 
![]()
![]()

Fossé : Voir douve.
Gué : Endroit où
le niveau de l’eau d’une rivière est assez bas pour la traverser à pied.
Guetteur : Les
guetteurs étaient postés en haut des tours ou des beffrois ; ils
étaient chargés de surveiller et de donner l’alerte.
Herse
: L’Herse est
une sorte de porte de bois, formée par deux séries de barres, les unes verticales,
les autres horizontales armées au bas par des pointes de fer. L’herse est
suspendue par une corde attachée à un treuil qui se trouve au-dessus de la
porte. L’herse tombe debout guidée par deux coulisses taillées des deux
côtés de la porte. ![]()
![]()


Hourd : Le hourd est un ouvrage en bois, dressé au
sommet des courtines ou des tours ;
il est destiné à recevoir les défenseurs. Surplombant le pied de la maçonnerie, il
donne un flanquement plus étendu et
une saillie très favorable à la défense.
Mâchicoulis : Les
mâchicoulis sont des sortes de balcon construits au sommet des tours ou des murailles ;
ouvert dans la partie inférieure il permettait de surveiller et de protéger le pied du
mur par des jets de projectiles, empêchant l’ennemi de détruire le bas du mur par la
mine.

Meurtrière : Fente
verticale pratiquée dans un mur de fortification pour le tir à l’arc,
l’arbalète ou le mousqueton. ![]()
![]()

Murette (ou Lice) : Nom
donné d’abord aux palissades de bois
d’ont
on entourait les places ou châteaux fortifiés. Elles étaient placées en avant des fossés.

Pilori : Appareil
où l’on exposait publiquement les condamnés. Ce
supplice a été supprimé en 1789. Il existait deux sortes de pilori : -
L’un était un poteau garni d’un carcan qu’on passait au cou du condamné. -
L’autre, composé de deux planches en bois, était percé de trous pour les
bras et la tête.
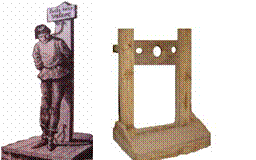
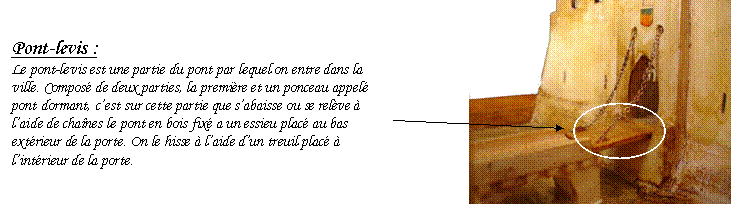
Poterne : Petite
porte dérobée de fortifications donnant sur le fossé permettant la communication
vers l’extérieur en cas de siège.
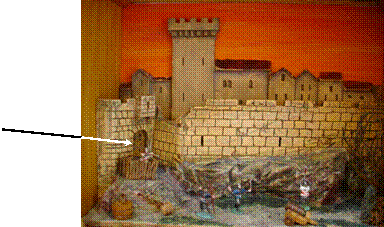
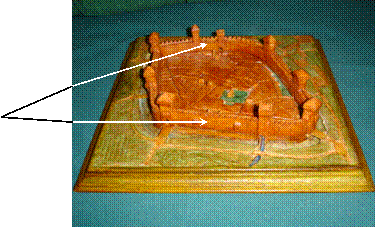
Sénéchal : Officier
féodal, qui dans un certain ressort, était chef de justice. Voir baillis.
Tocsin : Bruit d’une
cloche que l’on frappe à coups répétés pour donner l’alarme.